Amal. Un esprit libre
Film de Jawad Rhalib (17 avril 2024)
Entretien avec Jawad Rhalib et Lubna Azabal

Amal est enseignante de lettres dans un lycée de Bruxelles et elle encourage ses élèves à s’exprimer librement, consciente de l’importance d’éveiller leur esprit critique. Mais le professeur de religion, Nabil, s’en mêle et fait pression pour qu’elle retire certains des textes qu’elle propose. Amal refuse, car son choix de faire découvrir à ses élèves cette poésie classique, jugée délictueuse par Nabil, est essentiel, non seulement pour faire réfléchir sur les tabous et les préjugés, prôner la liberté d’expression, mais également pour faire cesser les attaques contre Monia, l’une de ses élèves harcelée par une partie de la classe, radicalisée. À la suite d’une violente altercation en classe, Amal en discute et le signale en réunion avec les autres professeurs et la directrice, sans que cela soit pris réellement au sérieux…

Avec Amal, un esprit libre, explique Jawad Rhalib, « mon objectif était de traiter la question de l’influence de la communauté musulmane au sein de nos écoles, et à mettre en lumière la peur que cela peut susciter chez les enseignants. Il est rare de trouver des professeurs, à l’instar d’Amal, qui sont capables et désireux de s’opposer aux pressions des parents et des associations religieuses. Mon but était de donner une voix à ce corps enseignant et, surtout, de mettre ce constat en lumière. »
Cet entretien s’est fait en duo, avec Jawad Rhalib et Loubna Azabal, les deux défendant le film avec passion…

Pour commencer cet entretien, il m’a paru important de souligner un lien entre les personnages incarnés par Loubna Azabal, dans deux films, Le Bleu du caftan de Maryam Touzani et le film nous parlons aujourd’hui, Amal, un esprit libre de Jawad Ghalib…
Illustrations musicales : Amine Bouhafa, La Belle et la meute. Bachar Mar-Khalifé, Ya Nas, Le Prophète.
Le jour où j’ai rencontré ma mère (Kiddo)
Film de Zara Dwinger (17 avril 2024)

Lu rêve de sa mère dans son foyer d’accueil, une mère géniale, cascadeuse à Hollywood, alors évidemment lorsque celle-ci doit venir la chercher, tous les fantasmes sont permis. C’est juste pour quelques jours, mais quand même ça brise la monotonie. À l’arrivée de Karina dans sa vieille Chevrolet, tout est un peu bousculé, mais Lu se dit que n’importe comment ça sera super, et lorsque sa mère lui propose de fuguer et de partir en Pologne, elle est un peu perturbée par le changement de programme et s’inquiète par rapport à la responsable du foyer. Mais bon, il ne faut pas gâcher l’aventure et pas question de contrarier sa mère, et les voilà sur la route, portant perruques et bottes santiags, mangeant dans les restaus et partant sans payer, roulant n’importe où… C’est excitant une mère marginale, Lu est complètement séduite et s’amuse beaucoup, même si le portrait qu’elle se faisait de sa mère ne correspond pas vraiment à la réalité… mais qu’importe, c’est une évasion, et elle est heureuse de la fantaisie et de l’immaturité de Karina.

Les films d’ados sont nombreux, mais Zara Dwinger réussit un road movie touchant, facétieux, avec de nombreux rebondissements, qui se distingue par sa construction, ses trouvailles et une originalité soutenue par le jeu des deux comédiennes, qui semblent se délecter, chacune dans son rôle, sur jouant lorsque c’est nécessaire avec une complicité évidente. Le jour où j’ai rencontré ma mère est aussi une réflexion sur la parentalité, d’autant que les rôles mère / fille sont soudain inversés.

Ce premier long-métrage de la réalisatrice Zara Dwinger donne aussi un aperçu de l’évolution de l’amour filial, lorsque Lu découvre les faiblesses de sa mère, et même si elle n’a plus la même admiration qu’elle lui portait, elle l’aime plus et différemment, en se retrouvant dans des rapports d’égalité qu’elle n’imaginait pas. Et puis jouer un rôle de blasée avec le jeune garçon qu’elle rencontre, c’est amusant. De la même manière, s’imaginer en Bonnie and Clyde avec sa mère c’est extraordinaire, plutôt que d’affronter une réalité de leur passé familial peut-être décevant, c’est une façon de prendre son destin en mains, donc de s’émanciper. Et dire « Take the Money and run » ! Quoi de plus loufoque et jouissif ? On pourrait dire que les fantasmes et les jeux de rôles au cours du voyage apportent à Lu un début de maturité.
« Je voulais conserver la perspective de Lu [explique la réalisatrice]. C’est comme ça qu’on fait l’expérience de la vie en tant qu’enfant : on n’a pas toutes les réponses, juste une vision d’ensemble. Et puis à la fin, ça n’a pas vraiment d’importance. Karina n’a pas toujours été là pour son enfant, elle est imprévisible, mais elle l’aime, alors elles vont essayer de faire en sorte que ça fonctionne entre elles. J’aime le fait qu’on laisse les choses comme ça, en plein milieu. »
Le jour où j’ai rencontré ma mère (Kiddo) de Zara Dwinger au cinéma le 17 avril.
Civil War
Film de Alex Garland (17 avril 2024)

« Si nous oublions notre Histoire, nous sommes condamnés à la répéter », dit Alex Garland, mais faudrait-il encore qu’elle soit enseignée dans les écoles états-uniennes. Civil War semble un écho de la violence systémique régnant aux Etats-Unis, qui, faut-il le rappeler, ont été fondés sur le génocide des populations indiennes, sur la conquête et la destruction de territoires vierges et sur l’esclavage. En regard de l’Europe et d’autres pays dans le monde, c’est une nation neuve, constituée par une myriade de peuples, venus d’un peu partout, et où la violence a en effet été une constante — colonisation, guerre de sécession, fascisme rampant, mouvements sociaux, contestation et manifestations brutalement réprimées, racisme, libre circulation des armes, etc. Donc, ce film d’Alex Garland n’est pas une dystopie, mais plutôt une hypothèse très probable. On garde en tête le meurtre de George Floyd en 2020, les émeutes qui ont suivi, avec la création de Black Lives Matter, des émeutes qui rappellent aussi celles de Watts en 1965, de même que celles en réaction au tabassage de Rodney King en 1992, enfin l’attaque du Capitole après la défaite électorale de Donald Trump. La liste est interminable et le constat est effarant.

Le film commence avec des images floues, la caméra cherchant à faire le point, entrecoupé de plans rapides de manifestations… Le Président quelque peu dépassé par les événements, répète le discours qu’il s’apprête à « interpréter » devant les caméras, mais cela n’a guère de sens, puisque sa déclaration est en total décalage avec la réalité d’un pays en déliquescence. La guerre civile oppose les Forces de l’Ouest, une alliance armée d’États en rébellion, au gouvernement fédéral, dont la capitale, Washington DC est encerclée par les rebelles sécessionnistes. Il est intéressant de noter que Washington représentait la ligne de partage entre les états esclavagistes du Sud et ceux du Nord, et que la ville a été construite en grande partie par la main-d’œuvre africaine-américaine à partir du XIXème siècle.
Lee (Jouée par Kristen Dunst) est une photojournaliste de guerre chevronnée, elle assiste, consternée, à ce qui se déroule dans le pays, entre images télévisées, échanges de tirs dans la rue et explosions. Elle couvre les événements et décide, avec Joel, un collègue journaliste, de partir à Washington et d’obtenir la dernière interview du Président. Sammy, un journaliste plus âgé, les accompagne et une jeune photographe, Jessie, s’incruste dans le groupe. Dans l’une des premières scènes, Lee dit à Sammy : « Chaque fois que j’ai survécu à une zone de guerre, j’ai cru que cela servirait de mise en garde chez nous. Et pourtant, voilà où nous en sommes. »

Trois générations de journalistes, de témoins qui risquent leur vie pour rapporter des images, des faits, peut-être aussi dénoncer la violence, mais en même temps c’est excitant comme l’exprime Jessie, « ces derniers jours, je n’ai jamais eu autant peur, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante ».
De New York à Washington DC, c’est 1383 kilomètres à travers un pays dévasté, sur la route, des voitures abandonnées, accidentées, un paysage parfois saccagé et, à chaque tournant, chaque arrêt, des rencontres où l’on côtoie le deal, la barbarie, l’individualisme forcené, des charniers, des gens torturés… Tuer ou être tué, les gens ne se préoccupent plus de qui on est, ou de quel bord on est : reste tuer pour survivre ou vaincre la peur. Et même lorsque l’on croit être dans un havre de paix, complètement anachronique, il y a des gardes armés sur les toits, « nous, on essaie de rester en dehors de tout ça. Avec ce qu’on voit aux infos c’est le mieux à faire », commente la vendeuse du magasin.

Un road movie à l’intérieur de la guerre, dans un pays déchiré, où les gens ne se parlent plus, mais où l’arme devient un symbole de puissance et un moyen de dominer les autres et sa propre peur. Civil War dépeint de manière terrifiante les conséquences humaines de la guerre. Les images atteignent une authenticité fulgurante avec les ballets d’hélicoptères en rase motte et les avions striant le ciel : « toute nation engagée dans un conflit est confrontée aux mêmes problèmes. Qu’il s’agisse d’une guerre civile ou d’une guerre avec un pays voisin, la réalité de la guerre reste la même », déclare Alex Garland, qui réalise là « un film de guerre d’un genre radicalement nouveau : un thriller rempli d’action mais avec un véritable parti pris à propos des conflits armés. »

Que l’on regarde la base militaire en pleine effervescence où l’on retrouve l’impression du filmage foudroyant d’Apocalypse Now, les paysages détruits et les forêts en feu près de la route, les rues de Washington transformées en zones de guerre, l’explosion du Capitole ou encore l’entrée en force dans la Maison blanche, on est frappé par la force des images et leur rythme qui transposent un cri d’alarme en réalité terrible et angoissante, proche et palpable. « J’ai écrit le scénario avec un mélange de colère et d’anxiété [raconte Alex Garland]. Malgré le long processus que représente la réalisation de ce film, ce sentiment de frustration n’a pas diminué, il s’est même amplifié. »

Si le film montre une situation politique exacerbée et comment un pays glisse dans un chaos, où seule demeure la barbarie, Alex Garland espère que le public perçoive le signal d’alarme et prenne conscience de la guerre larvée qui peut éclater à tout moment. « J’ai été élevé à l’époque du post-hippie-punk [explique-t-il], une partie de moi aspire à faire quelque chose de subversif ». Civil War est en effet une œuvre subversive condamnant la guerre, et une critique acerbe de la situation politique et sociale aux États-Unis. Un film passionnant et à ne pas manquer aussi pour la bande son. Dream Baby Dream termine le film et lance le générique de fin, mais il est difficile de savoir si la chanson représente un espoir…
Civil War d’Alex Garland est à voir sur grand écran à partir du 17 avril 2024.
Le temps du voyage
Film de Henri François Imbert (24 avril 2024)

En 1994, une grande exposition fut organisée dans le parc de la Villette, La route tsigane, qui remontait aux origines des Roms. Originaires du Nord de l’Inde, ils appartenaient à des castes de musiciens, entre le IXe et le XIe siècle. Certains ont parcouru l’Iran, la Turquie, la Roumanie, l’Europe, de l’Est en Ouest. Dans chaque pays traversé, certains en ont adopté la langue, les coutumes et ont formé des groupes différents au cours du voyage, tout en conservant leur langue commune, le Romani, proche du sanscrit, langue sacrée de l’Inde ancienne. La première trace de leur apparition en France date de 1419, au nord de Lyon, où ils présentèrent des lettres de protection de l’Empereur Sigismond, Roi de Bohême. C’est pour cette raison qu’on leur donna le nom de Bohémiens.
En 1940, le gouvernement de Vichy ordonna l’internement de tous ceux et celles qu’il nommait les « Nomades ». C’est ainsi que 6.500 Tsiganes de nationalité française furent emprisonnés dans une trentaine de camps en France, jusqu’en décembre 1945, dont 700 enfants, 16 mois après la libération d’Orléans. Trois jours avant les visites de la Croix rouge dans les camps, de la nourriture était distribuée et le camp nettoyé.

À lire un livre essentiel sur la question, celui de Claire Auzias, Samudaripen. Le Génocide des Tsiganes. (éditions L’Esprit frappeur) « Le métissage est présenté comme responsable de la chute des grands empires et la question de la pureté raciale comme la clé de voûte de l’histoire du monde », prévient d’emblée Olivier Mannoni, le préfacier de cet ouvrage pionnier. Samudaripen (« Tuez-les tous » en romani, la langue des Tziganes et des Roms) est un travail de synthèse majeur, et cette troisième édition est entièrement refondue depuis celle, initiale, de 1999. Il s’agit bien, comme pour les Juifs, d’un génocide racial : ils ont été assassinés par les nazis non pas pour ce qu’ils pensaient mais pour ce qu’ils étaient. À la différence des Juifs, ils ont une culture de l’oralité ; et comme le rappelle Claire Auzias, ils constituent un peuple « non pas du souvenir mais de l’oubli ». Oubli… alors que sur une population totale en Europe de 700 000, 500 000 environ ont disparu, soit 70 % ! (extrait de la note critique de Jean-Jacques Gandini).
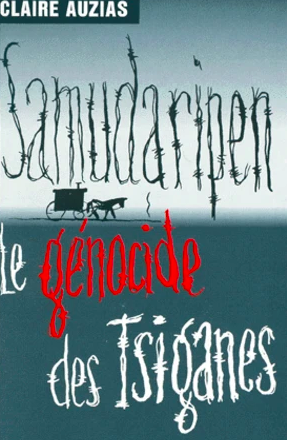
Le film de Henri François Imbert, Le Temps du voyage, en remontant l’histoire des Roms, questionne le présent des Tsiganes aujourd’hui, cinq siècles après leur arrivée.
Les Tsiganes sont environ 400.000 en France, les Gens du Voyage, nomades ou sédentaires, de nationalité française depuis des générations, ont obtenu la Carte Nationale d’Identité française seulement depuis 2016. Avant cette date, leur « Carnet de circulation » devait être visé par l’administration tous les trois mois. La disparition de ce signe institutionnel de disparité n’efface cependant pas la discrimination, dont est toujours victime cette partie de la population française.
Si l’on connaît certains artistes, le cinéaste Tony Gatlif, de nombreux musiciens, l’inventeur du Jazz Manouche, Django Reinhardt, les Tsiganes restent pratiquement inconnus et invisibles dans notre société, à laquelle ils et elles participent pourtant depuis cinq siècles. Quant aux politiques actuelles, elles poursuivent une mise à l’écart des Gens du Voyage, pratiquant diverses professions : forains, élagueurs, couvreurs-zingueurs, rempailleurs, saisonniers agricoles…
Par exemple, la loi du 31 mai 1990 stipulant, que les communes de plus de 5.000 habitants doivent créer des aires de stationnement adaptées à leur accueil, elles sont nombreuses à déroger à cette obligation, tandis que d’autres proposent des aires d’accueil mal équipées ou dans des zones industrielles polluées. Ce qui n’empêche pas le coût élevé du stationnement, comparable au prix de location d’un appartement et pour un temps limité, de plus aucune aide au logement ne leur est attribué, du fait d’habiter en caravane. Mêmes difficultés du côté des banques pour l’obtention de crédits.
Le tournage a commencé à Saint-Sixte, en 2016, au cours de la cérémonie de commémoration du massacre de quatorze Tsiganes assassinés le 23 juin 1944 par la Division SS Das Reich, les auteurs du massacre d’Oradour-sur-Glane.
À partir de ces rencontres, un lien s’est établi : la possibilité de faire un film ensemble. C’est alors que l’écriture du film a commencé, à travers les échanges et les conversations qui évoquent les difficultés au quotidien, la discrimination qui perdure et les productions artistiques. Le travail du réalisateur est de suivre les pistes proposées, d’entretenir les liens, se déplacer et découvrir ce que les personnages désirent inscrire dans le film. Une histoire à construire en partage. Ce qui ressort du film, en dehors du patrimoine culturel et artistique, c’est que ce peuple pacifiste a survécu grâce à la solidarité et n’a pas vraiment de frontières. Les personnages qui apparaissent dans le film incarnent un ensemble de valeurs, « telles que la place des enfants et la qualité de l’éducation basée sur la transmission familiale en dehors de l’école, cependant que perdure un ancrage profond dans des valeurs ancestrales basées sur le respect de la Nature et de l’Humain ».
Et l’on peut évidemment se demander quelles sont les persécutions aujourd’hui ?
Le temps du voyage de Henri François Imbert au cinéma le 24 avril 2024.
À propos des aires d’accueil, un livre important de William Acker, Où sont les « gens du voyage » ? Inventaire critique des aires d’accueil (éditions du commun).
Ce n’est pas un hasard si les plus proches riverains de l’usine Lubrizol, partie en fumée toxique fin septembre 2019 à Rouen, étaient les habitant·es de l’aire d’accueil des « gens du voyage » de Petit-Quevilly. Partout en France, les lieux « d’accueil » attribués aux personnes relevant de cette dénomination administrative se trouvent à l’extérieur des villes, loin de tout service, ou dans des zones industrielles à proximité de diverses sources de nuisances. Constatant l’absence de chiffres opposables aux pouvoirs publics sur l’isolement de ces zones et leur rôle dans les inégalités environnementales, William Acker a décidé de les recenser, département par département.

La première partie de cet ouvrage analyse le contexte historique, sociologique et politique de ces communautés et du rapport que l’État entretient avec elles. La seconde partie est l’inventaire exhaustif et cartographié des aires d’accueil. Cet inventaire s’appuie sur des critères précis et factuels comme la distance et la durée de trajet de la mairie à l’aire, la proximité immédiate de zones habitables ou de zones à risque sanitaire ou écologique (centrale nucléaire, déchèterie, usine, station d’épuration, etc.).
C’est un travail inédit qui permet de mettre en lumière, d’une part, l’antitsiganisme diffus dans toutes les strates de notre société et, d’autre part, l’encampement moderne de toute une partie de la population invisibilisée de l’espace et du débat publics. Les « gens du voyage » sont en première ligne d’un des grands enjeux de lutte du XXIe siècle : le racisme environnemental.
Deux livres à lire et un film à voir sur cette question des Roms.
Bushman
Film de David Schickele (24 avril 2024)
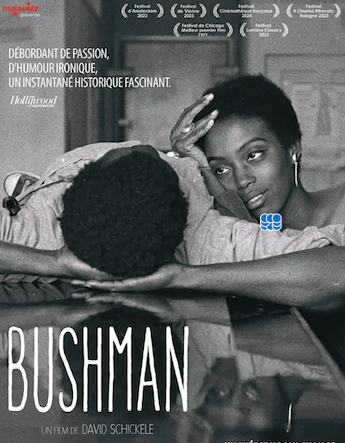
1968. Aux États-Unis, Martin Luther King, Robert Kennedy et Bobby Hutton, membre des Black Panthers, sont assassinés. Au Nigeria, la guerre civile entre dans sa deuxième année. Gabriel a fui le pays et vit à San Francisco, où il donne des cours à l’université et est au contact de la communauté africaine-américaine comme des milieux bohèmes. Sa vie d’exil est jalonnée de rencontres, d’escapades et d’errances, mais il reste habité de souvenirs et par la nostalgie du village de son enfance... Dans cette période mouvementée des années 1960, le visa de Gabriel arrive à expiration...
Particulier dans sa démarche, Bushman l’est aussi dans la distribution, puisque le film est resté inédit en France comme aux Etats-Unis. Sans doute, cela tient-il à ses conditions de production, à l’interruption du tournage, qui retarda son achèvement ; mais à le découvrir aujourd’hui, le film paraît beaucoup trop original dans le contexte de l’époque pour l’industrie cinématographique états-unienne. Effectivement, dans le contexte du Mouvement des droits civiques, de la répression brutale des manifestations et l’émergence des Black Panthers, la vision que le film donne à la fois de la bourgeoisie blanche et de la communauté africaine-américaine étaient alors certainement trop en décalage pour les salles de cinéma états-uniennes.

C’est le premier long métrage de fiction de David Schickele, influencé notamment par la nouvelle vague française, mais incontestablement inspiré par le cinéma de John Cassavetes, on pense à Shadows dans sa façon de relater les aventures de Gabriel, pris entre ses souvenirs en flash back et sa vie à San Francisco. La mise en scène joue sur le naturel, qui frise parfois l’improvisation, donnant ainsi au film un rythme surprenant et extrêmement original. Le cadre est également une belle découverte, quant au personnage de Gabriel, filmé entre deux mondes, il permet de découvrir toute la complexité et la richesse de ces années charnières, bouillonnantes et décisives de la décade 1960, par exemple pour les films qui vont suivre.

Portrait cinématographique d’un jeune exilé africain et des deux milieux en pleine révolution qu’il côtoie, cela donne l’impression, d’abord d’une certaine candeur, de spontanéité de Gabriel, enfin de l’interférence entre fiction et documentaire. Le film est décidément en avance sur son temps, ce qui a peut-être aussi gêné les distributeurs. Les pérégrinations d’un jeune intellectuel nigérian dans un San Francisco secoué par les mouvements sociaux et politiques d’alors, provoquent une sorte de mise en miroir décalé avec le conflit interne de son pays natal, cela donne aussi une toute autre perspective de la réalité et du sentiment d’identité double et troublé du jeune homme.
Bushman de David Schickele est en fait un portrait cinématographique double, d’un genre rare, qui joint la spontanéité à la poésie dans son approche d’événements réels, tant par les flash-backs du village nigérian de Gabriel que par la vie urbaine de San Francisco. Une belle découverte !
Bushman de David Schickele au cinéma le 24 avril.
Réimpression de Revenir à Naples de Paco Ignacio Taibo II (éditions Nada).
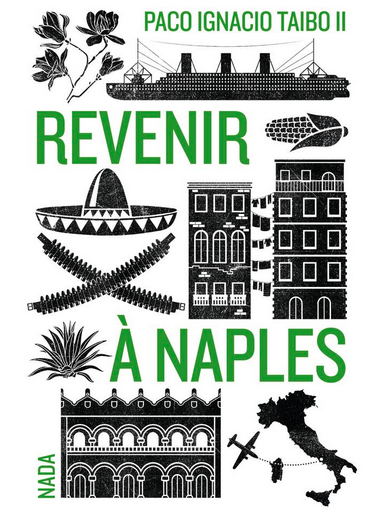
Veracruz, vers 1900. Un groupe d’anarchistes italiens, fuyant la misère et la répression, débarque au Mexique pour y fonder une commune agricole. Parmi eux, un prestidigitateur, une poétesse, un boxeur, une prostituée et même un curé. Mais, face à un gouvernement corrompu et des propriétaires terriens voraces, les apprentis paysans voient leur rêve d’une vie nouvelle vaciller. Pris dans la tourmente d’une révolution qui s’annonce, ils devront choisir leur camp.
Quatre-vingts ans plus tard, hanté par de vieux démons, Lucio Doria, le cadet de la bande, entreprend un retour rédempteur à Naples.
Humour et tragédie se conjuguent dans ce roman de Paco Ignacio Taibo II qui nous plonge au cœur des espoirs brisés des luttes révolutionnaires du XXe siècle.
CQFD n°229 (avril 2024)
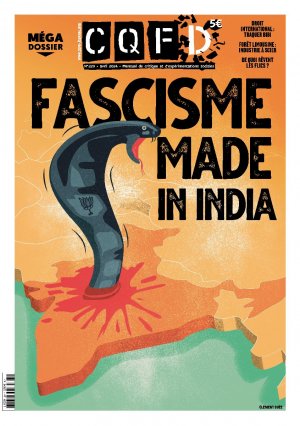
Dans ce numéro 229, un dossier spécial détachable sur l’Inde « Mousson brune : fascisme et résistances en Inde » nous emmène voir le pays le plus peuplé du monde autrement, auprès d’une société indienne qui tente de s’opposer à Narendra Modi et son suprémacisme hindou. Hors-dossier, des destinations plus improbables encore : CQFD s’invite dans les forêts du Limousin, à Montpellier observer la sécurité sociale alimentaire, et même dans la tête d’un flic. On y cause aussi droit international avec l’état d’Israël en ligne de mire, on y croise une renarde comme dans le petit prince, et on écoute les albums de Ben PLG et le pépiement des oiseaux printaniers.
